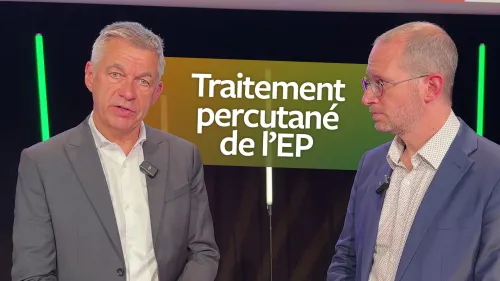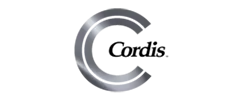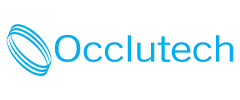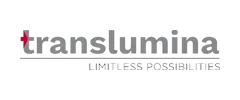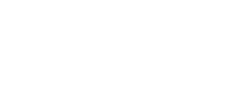Scènes de Méninges : quand les paramédicaux jouent le jeu
Le congrès du GRCI 2024 a été le théâtre d'une session interactive et particulièrement stimulante intitulée "Scènes de Méninges". Loin des présentations magistrales classiques, cette session paramédicale a mis à l'épreuve les connaissances des participants à travers des cas cliniques concrets et des questions pointues, le tout dans une ambiance conviviale.
L'objectif était double : réviser les fondamentaux en vue de la "Battle du GRCI" du lendemain et aborder des situations cliniques complexes de manière ludique. Pour pimenter le jeu, un système de vote interactif via un QR code permettait de recueillir les réponses en direct et de désigner le "super-para" de la session.
Acte 1 : Madame L., un cas de perforation coronarienne délicat
Le premier cas clinique présenté concernait Madame L., 64 ans, aux antécédents de tabagisme sévère et de dyslipidémie, admise pour des douleurs thoraciques suspectes avec un ECG initialement calme mais un troponine positif. Son petit gabarit (1m62 pour 45 kg) a nécessité une adaptation du cocktail radiologique lors de la coronarographie.
L'examen a révélé un réseau coronaire gauche sans lésion significative, mais une coronaire droite présentant une sténose calcifiée sur son segment 2. La décision d'une dilatation ad hoc a été prise. Après une prémédication et une héparinisation complémentaire, la lésion a été prédilatée avec différents ballons. C'est lors du contrôle après post-dilatation avec un ballon non compliant que la complication redoutée est survenue : une perforation coronarienne.
La session a alors mis les participants à contribution avec une série de questions incisives :
- Quelle est cette complication ? La réponse, massivement trouvée (75,64 %), était une perforation.
- Quelle classification permet de classer une perforation coronarienne ? La bonne réponse était la classification d'Ellis et Muller.
- Combien y a-t-il de types de perforation dans cette classification ? La réponse était cinq.
La classification d'Ellis et Muller a ensuite été détaillée, décrivant les différents types de perforation, allant du simple cratère extra-luminal à la perforation distale due au guide. Le cas de Madame L. a été identifié comme une perforation de type 3, une extravasation franche supérieure à 1mm.
Face à cette complication, la question cruciale de la conduite à tenir a été posée. La réponse attendue, et soulignée par les recommandations présentées, était l'inflation répétée et prolongée d'un ballon au niveau de la perforation, suivie de la mise en place d'un stent couvert.
Une technique spécifique pour la mise en place d'un stent couvert en cas de perforation, la technique "ping-pong", a également été expliquée. Elle consiste à maintenir un ballon gonflé au niveau de la perforation via un premier accès artériel tout en introduisant un deuxième cathéter guide par un autre accès pour déployer le stent couvert.
La complication majeure à redouter en cas de perforation coronarienne, la tamponnade, a été abordée, ainsi que la conduite à tenir : appel de renfort, préparation du matériel d'échographie pour un drainage péricardique écho-guidé, et en dernier recours, intervention chirurgicale.
Le déroulement du cas de Madame L. a confirmé l'application de ces principes : inflation du ballon, drainage d'une tamponnade par le cardiologue de garde, soutien hémodynamique par le réanimateur, puis mise en place d'un stent couvert avec un résultat satisfaisant.
Acte 2 : Madame C., une réaction allergique sévère en salle de cathétérisme
Le deuxième cas clinique a plongé l'audience dans une situation d'urgence d'un autre type : une réaction allergique chez Madame C., 48 ans, aux multiples facteurs de risque cardiovasculaires et aux antécédents d'allergie à la pénicilline et de non-observance de son traitement antiagrégant. Admise pour un SCA avec sus-décalage du segment ST, elle a brutalement présenté des signes de malaise, de confusion et de difficultés respiratoires après l'introduction des cathéters.
La question immédiate était : quelle est la complication envisageable la plus probable ? La réponse correcte était une réaction allergique. Les signes possibles d'une telle réaction (prurit, œdème, difficultés respiratoires) ont été passés en revue, soulignant l'importance d'un examen clinique attentif.
L'anamnèse de Madame C. a révélé un élément clé : un asthme sévère, terrain favorisant les réactions allergiques. Face à l'aggravation rapide de son état, les critères évoquant un choc anaphylactique (hypotension, tachycardie, signes d'œdème de Quincke) ont été rappelés, ainsi que la classification de Ring et Messmer pour évaluer la sévérité de la réaction.
La conduite à tenir immédiate en cas de choc anaphylactique de grade 3 avec atteinte cardiovasculaire et respiratoire a été la question suivante, insistant sur l'aspect "immédiat" : éviction de l'allergène en priorité et injection d'adrénaline par voie intramusculaire (0,5 mg), en tenant compte du contexte d'héparinisation où la voie intramusculaire est préférable à la voie sous-cutanée.
Après la prise en charge initiale (adrénaline, oxygénothérapie), l'état hémodynamique de Madame C. s'est amélioré. La discussion s'est ensuite orientée vers la prise en charge post-examen : bilan allergologique, mention du type de produit de contraste utilisé dans le compte rendu opératoire, et en cas de nouvel examen nécessaire, privilégier d'autres modalités (écho, IRM) ou utiliser un autre produit de contraste avec une prémédication antiallergique et une équipe préparée à toute complication.
Un point important a été souligné : l'allergie à l'iode n'existe pas. Les réactions sont dues aux excipients présents dans les produits de contraste.
Acte 3 : Madame B., une dissection coronarienne complexe
Le troisième cas clinique a mis en lumière une complication mécanique : une dissection coronarienne chez Madame B., 74 ans, admise pour un angor d'effort et de repos avec des ondes T négatives à l'ECG et une akinésie apicale à l'échographie. La coronarographie a révélé une lésion significative sur l'IVA.
Après l'installation d'un Slender™ dans la radiale droite, la coronarographie diagnostique a confirmé l'IVA comme artère coupable. L'opérateur a décidé d'une angioplastie immédiate. Une question a porté sur le flux TIMI attendu après le passage du guide dans une lésion avec un flux altéré : la réponse correcte était TIMI 2 puis 3 au passage du guide. La classification TIMI a été rappelée pour illustrer les différents grades de flux coronaire.
Le résultat initial de la pose du stent sur l'IVA a été jugé non satisfaisant en raison d'une sous-expansion du stent en partie médiane, facteur de risque de resténose. La question suivante a porté sur le risque de post-dilater une lésion avec un thrombus peu organisé (thrombus "qui tapisse la paroi" dans un contexte d'angor évoluant sur trois jours) : le risque principal était l'embolisation distale.
Face à ce résultat suboptimal, les participants ont été interrogés sur les techniques permettant d'améliorer le support du cathéter guide : toutes les propositions étaient valides (autre cathéter guide, extension de cathéter, deuxième guide controlatéral, "bodywire", ballon d'ancrage), bien qu'avec des priorités différentes. L'opérateur a opté pour une extension de cathéter.
Malheureusement, la tentative de post-dilatation a entraîné une dissection coronarienne. La question suivante a porté sur le type de dissection selon la classification de Flag : il s'agissait d'une type B. Les caractéristiques angiographiques des différents types de dissection ont été détaillées.
La conduite à tenir face à cette dissection de l'IVA proximale s'étendant de manière rétrograde vers le tronc commun et la circonflexe a nécessité une réflexion approfondie. La réponse correcte était de ne pas gonfler de ballon dans le tronc commun, de ne pas retirer l'extension de cathéter et le guide dans l'IVA, de sécuriser la circonflexe avec un guide souple, et de différer la post-dilatation de l'IVA moyenne. La justification de ces choix stratégiques a mis en évidence la complexité de la prise en charge des dissections touchant les bifurcations coronaires.
Le traitement réalisé a consisté en un "kissing stent" au niveau de la bifurcation tronc commun-circonflexe, avec un résultat immédiat satisfaisant malgré une dissection résiduelle contenue sur l'IVA proximale, nécessitant une revascularisation ultérieure de l'IVA moyenne.
Acte 4 (Bonus) : quand la réanimation cardiopulmonaire devient essentielle
Un dernier acte, plus court, a abordé la prise en charge de l'arrêt cardiorespiratoire en salle de cathétérisme, rappelant les rythmes choquables (fibrillation ventriculaire et tachycardie ventriculaire sans pouls) et la première étape cruciale : vérifier l'état de conscience et les signes de respiration.
La conduite à tenir en cas d'asystolie a été rappelée : injection d'adrénaline (1 mg IVD) en s'assurant de la bonne prescription et en utilisant une communication en boucle fermée. La fréquence d'administration de l'adrénaline en cas de rythme non choquable est de toutes les 3 à 5 minutes (ou tous les deux cycles de massage cardiaque).
Conclusion : un apprentissage interactif et mémorable
La session "Scènes de Méninges" du GRCI 2024 s'est avérée être une méthode d'enseignement particulièrement efficace et engageante. En plaçant les participants au cœur de situations cliniques complexes et en les stimulant par des questions ciblées, les organisateurs ont réussi à favoriser la révision des connaissances et l'acquisition de réflexes essentiels en cardiologie interventionnelle. Le format interactif, la promesse d'une récompense et l'humour distillé tout au long de la session ont contribué à créer une atmosphère d'apprentissage dynamique et mémorable. Nul doute que les participants étaient mieux préparés pour la "Battle du GRCI" du lendemain, forts de ces "scènes de méninges" enrichissantes.